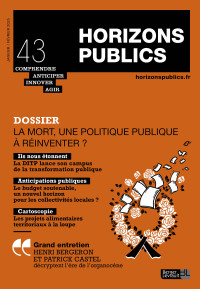Dans le cadre de sa thèse La mort « ordinaire », un problème public ? Étude des politiques publiques de gestion de la mort en France1, Alèxe Duvaut remet en perspective les politiques publiques liées à la mort. Elle revient sur la notion de « services publics funéraires » et interroge la capacité d’innovation des collectivités territoriales en matière de politique funéraire.
La mort est un phénomène qui implique une réflexion collective sur la manière dont on doit en disposer, et sur la nature du lien entre les vivants et les morts. Comment la société française traite-t-elle la mort ? Prendre pour objet de recherche les politiques publiques de la mort, c’est d’abord considérer que la mort est sujette à l’intervention du pouvoir politique. En effet, si certains auteurs parlent de « déni de la mort » 2, en termes de politiques publiques, il serait réducteur de parler de déni, ou même de tabou. Que ce soit à l’échelle nationale ou à l’échelle locale, la mort est l…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner