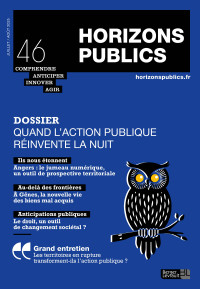Revue
DossierLa nuit vue par un écologue

La pollution lumineuse s’est aujourd’hui imposée comme un sujet de haute importance qui capte l’attention de nombreux acteurs. Au fil des années, éclairagistes, concepteurs lumières, médecins, écologues, urbanistes se sont emparés de cette problématique initialement portée dans la société par les astronomes. Cet intérêt collectif est une victoire dont les pionniers du sujet ont rêvé !
Dans le même temps, cette situation engendre une pluralité de visions, saine, mais complexe à mettre en musique. Des notions « évidentes » en vérité ne le sont pas et peuvent se traduire par des objectifs hétérogènes. Pollution lumineuse, besoins, sobriété, paysage nocturne, trame noire : comment l’écologue se positionne-t-il dans ce panorama de termes clefs ?
Loin de vouloir présenter la vision de tous les écologues, je présente ici la mienne. Il est important que la voix des écologues soit portée et à un niveau ambitieux, pour la biodiversité, en quelque sorte « au nom des non-humains », tout en sachant qu’une concertation, un arbitrage, un compromis sera ensuite fait par les humains à l’aulne de critères variés dans les projets développés.