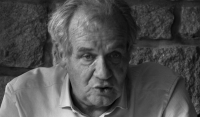Les Journées Françaises de l'Évaluation (JFE), créées par la Société Française de l'Évaluation (SFE) en 1999, célébraient en 2025 leur 25 ans. Sous le thème « Évaluation en transition(s) », ces journées, organisées les 30 et 31 octobre à Sciences Po Rennes, ont réuni 500 professionnels autour des enjeux de transitions (écologique, social, numérique et démocratique). Nous avons rencontré Virginie Besrest, présidente de la SFE, à l’occasion de cet événement pour faire le point sur l’avenir de cette discipline et son rôle face à l’urgence climatique et sociale.
Avant de plonger dans le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter rapidement ainsi que la Société Française de l'Évaluation ?
Je suis présidente de la Société Française de l'Évaluation (SFE) depuis juin 2024, et par ailleurs cofondatrice et gérante de Quadrant Conseil, une SCOP dédiée à l'évaluation et à l’appui à conception de politiques publiques. La SFE est une association loi 1901 qui a été créée en 1999, elle fonctionne donc depuis un peu plus de 25 ans grâce au bénévolat. Elle rassemble une grande diversité d'acteurs : des évaluateurs publics et privés, des agents publics, des…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner