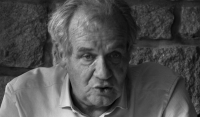Deux jours pour interroger les pratiques, poser les bases d’une culture commune et surtout donner un visage à celles et ceux qui innovent dans l’ombre. À L’Autre Canal et à l’INSET de Nancy, les premières Assises de l’Innovation Publique, organisées les 1er et 2 octobre derniers par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ont rassemblé plus de 300 participants — agents territoriaux, élus, chercheurs et partenaires. Retour sur les temps forts.
Lancée par Mathieu Klein, maire de Nancy et Yohann Nedelec, président du CNFPT, la plénière d’ouverture a donné le ton de ces Assises dès les premières minutes : l’heure n’est plus à la simple discussion, mais à l'action face à un contexte de crise profonde. Yohann Nedelec a déclaré que « l’innovation est une condition de survie pour nos organisations publiques ». Il a rappelé que l'innovation est une priorité absolue, notamment pour la fonction publique territoriale, et qu'elle est avant tout au « service des usagers et des habitants ». L'objectif affiché des Assises n'est pas seulement de…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner