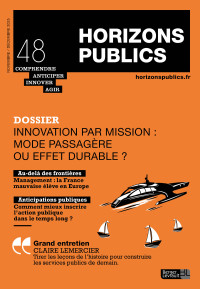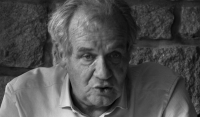Marseille fait partie des neuf villes françaises engagées dans la mission « 100 villes neutres pour le climat et intelligentes en 2030 », pilotée par l’Union européenne, dont l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030. Cette « mission villes » est un exemple à l’échelle européenne de « l’innovation par mission ». Entretien avec Camille Spaeth, chargée de mission « Marseille 2030 Objectif Climat » sur les avantages et les limites de ce programme européen.
Marseille a été la première ville française à déposer un contrat Ville Climat et l’une des 23 premières villes européennes à obtenir le label « Ville climatiquement neutre et intelligente ». Quelle est la signification de ce label pour Marseille, et comment le contrat Ville Climat a-t-il été élaboré pour refléter l’engagement de la ville ?
Le contrat Ville Climat a été élaboré en 2023, à la suite d’une candidature initiale de Marseille à cette mission européenne qui avait été fortement soutenue par de nombreux partenaires du territoire. Il y a eu une volonté claire d’adopter une démarche…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner