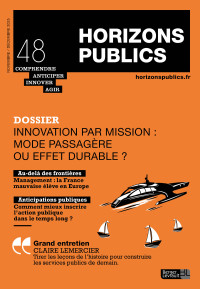Et si un quartier devenait le terrain d’expérimentation d’un futur plus équitable ? Camden, un arrondissement au cœur de Londres, a adopté l’approche mission après la crise du covid-19. Retour d’expérience.
Printemps 2020. La pandémie de covid-19 frappe de plein fouet Camden, un arrondissement au cœur de Londres. Le contraste est saisissant : d’un côté, les sièges britanniques de Google et de Facebook, les universités prestigieuses, comme l’University College London (UCL), et les rues animées de Camden Town ; de l’autre, des logements insalubres qui se multiplient, le plus fort taux d’enfants sous le seuil de pauvreté ainsi que le plus fort taux de sans-abri d’Angleterre, et des inégalités ethniques et sociales qui explosent avec la crise sanitaire. À Camden, plus qu’ailleurs, la crise sanitaire…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner