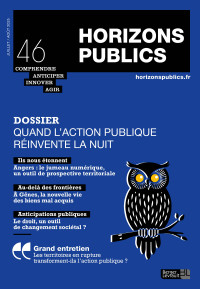Beyrouth, jadis phare de la modernité arabe et refuge des intellectuels, a façonné au fil du XXe siècle une effervescence culturelle unique, nourrie de nuits vibrantes de débats, de théâtre et de poésie.
« Beyrouth, dame (souveraine) du monde… Ô Beyrouth » : tels furent les mots du poète syrien Nizar Qabbani, quand la ville retrouva la paix après une longue guerre civile (1975-1990). Quelques années plus tôt, le poète palestinien Mahmoud Darwich proclamait : « Beyrouth, notre dernière tente » – le terme "tente" signifiant refuge. En effet, Beyrouth fut pendant des décennies, y compris durant les premières années du conflit, le refuge et le foyer des intellectuels, artistes, écrivains et opposants arabes.
Selon Ibn Khaldoun, une ville constitue un espace structuré que la nation investit comme…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner