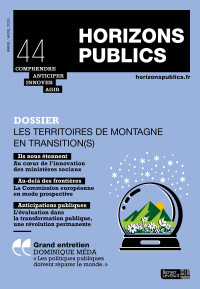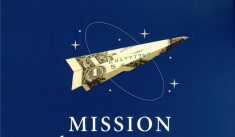Comment la Commission européenne s’appuie-t-elle sur la prospective pour nourrir ses plans d’action ? À l’occasion de la sortie des livres Futurs et La prospective en action1, organisée le 28 janvier 2025 à Paris par le Réseau international de recherche en prospective (International Foresight Research Network), rencontre avec Laurent Bontoux, expert en prospective au Centre commun de recherche européen en prospective.
Un parcours historique jalonné d’évolutions
L’histoire de la prospective au sein des institutions européennes remonte à la fin des années 1980. Des initiatives clés ont marqué cette évolution sous l’impulsion de Jacques Delors, l’ancien président de la Commission européenne2, notamment la création de l’office d’évaluation des sciences et des technologies (STOA) en 1987 et de l’Institut de prospective technologique en 1989. Ces premières étapes ont été suivies par une période de consolidation, jusqu’à un tournant majeur en 2017 avec la création du Centre de compétences en prospective. L’année…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner