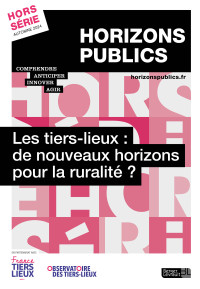Web
ActualitésRémy Seillier : « Les tiers-lieux seront amenés à s’appuyer davantage sur les collectivités territoriales »

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2026 prévoit une ligne budgétaire pour le développement des tiers-lieux de 0,7 million d’euros, ce qui représente une chute vertigineuse par rapport aux 13 millions d’euros alloués en 2024 et aux 8 millions d’euros votés en 2025. Pour Rémy Seillier, directeur général adjoint de France Tiers-Lieux, la pérennité de l'écosystème des tiers-lieux en France est remise en question.
Cette réduction brutale des fonds pourrait entraîner la fin du programme Fabriques de territoire porté par l’ANCT, qui soutient de nombreux tiers-lieux ressources développant des services de proximité et des activités économiques au sein de territoires fragiles. Elle affectera également le programme Accompagner les tiers-lieux de France Tiers-Lieux qui a permis à près de 300 lieux d’être accompagnés en 2025 via du compagnonnage, des accompagnements collectifs et individuels, afin de consolider leurs modèles économiques.