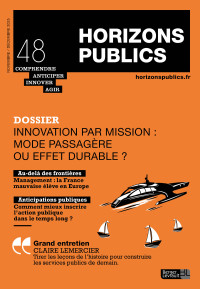Les problèmes actuels auxquels font face les pouvoirs publics appellent une réponse nouvelle. Les politiques d’innovation axées sur des missions (Mission-Oriented Innovation Policies ou MOIP) ou « approche mission » sont la réponse institutionnelle à ces grands défis sociétaux.
Il s’agit d’affronter des objectifs ambitieux d’une extraordinaire complexité (wicked-problem) : cela peut être de décarboner le système énergétique (Royaume-Uni), assurer une vie en bonne santé d’au moins cinq ans de plus qu’aujourd’hui pour chacun tout en réduisant les inégalités de soin de 30 % en dix ans (Pays-Bas), ou encore d’assurer un accès pour tous à un logement décent, climatiquement neutre et abordable (Barcelone). Il s’agit d’accompagner la société d’un équilibre insatisfaisant vers un nouveau cadre de vie désirable. Le défi se trouve en particulier dans le fait que le problème…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner