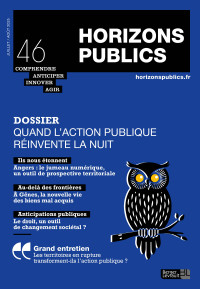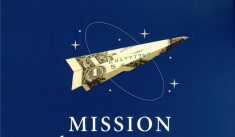Dans la ville italienne, les biens confisqués à la criminalité organisée ont été redonnés à la collectivité et une partie transformée en logement social et solidaire. Un exemple que commence à suivre la France, dont le dispositif se met progressivement en place.
C’est une ruelle étroite et sombre comme il y en a beaucoup à Gênes. Ce vicolo du quartier de la Maddalena n’a, à première vue, rien de particulier à offrir. En s’engouffrant dans la pénombre, on découvre pourtant trois biens confisqués à la criminalité organisée et réutilisés à des fins sociales. D’abord, un garage à vélo. Puis, la Casa dei papà, une maison accueillant des parents séparés en proie à la marginalisation. Enfin, au quatrième étage d’un des bâtiments, au bout d’un escalier exigu, une plaque de verre accrochée à la porte annonce la Casa Maddalena : « Bien confisqué à la…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner