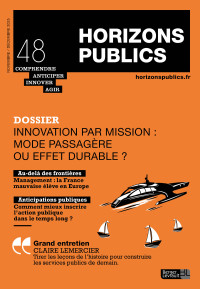Face aux transitions écologique, numérique et sociétale, quel visage auront les services publics en 2040 ? Comment réinventer un service public plus humain, agile et résilient dans un contexte de crises multiples et de ressources limitées ? Ces questions ont été au centre du séminaire annuel du Réseau Prospective Territoriale qui s’est tenu les 28 et 29 août 2025 à La Rochelle.
Organisé en partenariat avec le think tank Futuribles International, l’événement a réuni une soixantaine de participants, dont une cinquantaine issue des collectivités territoriales pour « repenser le rôle, la forme et les modalités d’action des services publics », selon Yohann Zermati, le président du Réseau Prospective Territoriale. Depuis mars 2025, ce réseau, qui rassemble des praticiens de la prospective en collectivité, a initié en partenariat avec Futuribles International, la démarche « Services publics 2040 » qui vise à explorer collectivement les futurs possibles des services publics…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner