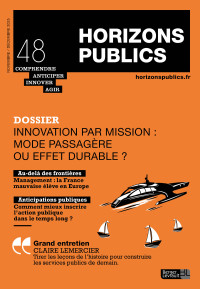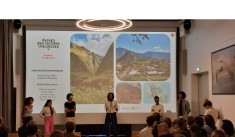Issu du mouvement altermondialiste, ce type de contrôle citoyen a connu des fortunes diverses, mais croise aujourd’hui le chemin de la démocratie participative et pourrait avoir trouvé un terrain d’action bien plus large.
Selon le Petit Robert, l’un des sens du mot « dette » est : « Le devoir qu’impose une obligation contractée envers quelqu’un. » Plus généralement, la définition du mot « dette » donnée par ce dictionnaire ne mentionne pas un autre devoir, pour un État ou une organisation publique, tout aussi impérieux que le remboursement : celui de rendre des comptes sur l’obligation contractée. Rendre des comptes à qui ?
Outre le Parlement ou la Cour des comptes, pourquoi pas aux citoyens ? Le contrôle par les citoyens des dettes contractées par les collectivités territoriales et plus largement encore le…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner