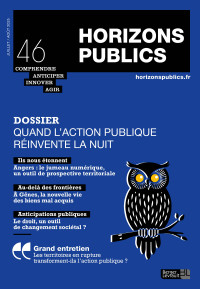Le travail de nuit représente un défi de taille pour les ressources humaines (RH). À Grenoble, le centre communal d’action sociale (CCAS) tente de relever le pari en repensant les modes de rémunération (prime variable), les parcours professionnels et l’équilibre vie privée-vie professionnelle de ses agents. Julien Durand, directeur RH du CCAS, nous livre les clés de cette équation complexe, entre contraintes réglementaires (régime indemnitaire fixe du travail de nuit) et innovations managériales.
Parmi les nombreuses organisations (police, pompier, transport, gardiennage, etc.) qui emploient des personnels la nuit en milieu urbain figurent les CCAS et notamment celui de la ville de Grenoble. Pour quelle(s) raison(s) ?
Permettez-moi avant tout de clarifier un point essentiel à propos du travail de nuit. On peut embaucher très tôt ou finir tard le soir : il ne s’agit pas alors de travail de nuit. Dans le cas du CCAS, les agents dont nous allons parler qui effectuent un travail de nuit prennent leur service à 21 h 00 et le termine à 7 h 00, soit dix heures de travail. De tels horaires…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner