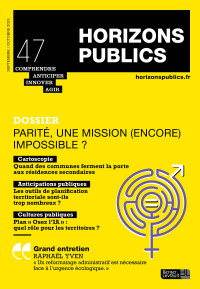Revue
L'actualité vue par...Gérard Blanchard, président de La Rochelle Université

Gérard Blanchard, élu à la présidence en janvier 2025, a un parcours atypique tant pour un chercheur que pour un élu. Ce fervent défenseur de l’interdisciplinarité et de l’ouverture d’esprit a en effet débuté sa carrière dans les domaines de l’écologie marine, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Professeur des universités à La Rochelle depuis 1998, il a créé en 2008 le laboratoire LIttoral Environnement et Sociétés (LIENSs), devenu une référence mondiale dans son domaine. Président de La Rochelle Université de 2008 à 2016, il a mené La Rochelle Université à l’autonomie en 2009 et a présidé le pôle Recherche enseignement supérieur Limousin-Poitou-Charentes.
Depuis 2016, Gérard Blanchard a été vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et du transfert de technologie. Il a aussi été conseiller municipal et communautaire de La Rochelle depuis 2020 et vice-président de la communauté d’agglomération de La Rochelle, où il a exercé des responsabilités en matière de transitions écologiques et énergétiques. Il a piloté le projet « La Rochelle territoire zéro carbone », élaboré et suivi le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), et présidé la SEM SÉnRgies, dédiée aux énergies renouvelables.