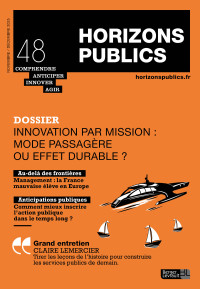Emmanuel Clavaud a été le directeur du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) de Lyon et du Rhône. À ce titre, il a témoigné de ce que le SDMIS a mis en place pour tenter de s’adapter aux aléas climatiques, toujours plus prégnants dans le cadre d’une journée organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) durant laquelle nous l’avons rencontré. Il revient également sur son expérience comme chef du 3e détachement au Canada, dans le cadre de feux de forêt hors normes. Il a depuis été nommé à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)1.
1 – L’adaptation des pompiers rhodaniens aux enjeux climatiques
Comment le SDMIS s’adapte-t-il à l’évolution des risques liés au changement climatique ?
Le SDMIS, répond à une intervention toutes les 4 minutes 30, c’est une machine qui ne s’arrête jamais. Nous avons intégré ces grands défis dans notre schéma d’analyse et de couverture des risques qui fixe la trajectoire des évolutions auxquelles nous devons nous préparer : c’est notre contrat opérationnel. Ce document oriente ensuite tous les plans d’action.
Quelles nouvelles technologies intégrez-vous pour mieux répondre à ces situations ?…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner