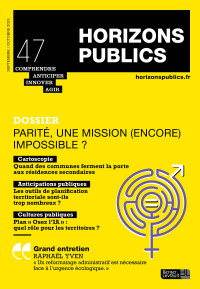Pour la XIIIe édition de son Printemps de la prospective, la Société française de prospective (SFDP) a réuni experts, prospectivistes et acteurs de l’innovation autour de ce thème. À quelques pas du canal Saint-Martin, dans les locaux de Cap Digital, cette rencontre a permis d’explorer les ruptures et les défis éthiques, sociétaux et même ontologiques posés par l’irruption fulgurante de l’intelligence artificielle (IA).
Mettre l’humain au cœur : la mission de la SFDP
L’événement a débuté par l’accueil des participants et l’ouverture par Carine Dartiguepeyrou, présidente de la SFDP. Elle a présenté les travaux de l’association et souligné sa mission de « mettre la prospective au service de la société ». L’objectif fondamental de la SFDP, récemment retravaillé avec les membres de son conseil d’administration, est de promouvoir une « réflexion prospective au service du progrès de l’humanité en harmonie avec le vivant et la terre ». La journée visait à mettre en évidence les points d’interdépendance de manière…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner