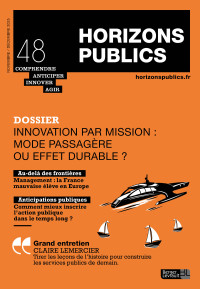Claire Lemercier, directrice de recherche CNRS en histoire et membre du Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris, a partagé son regard d’historienne sur les grandes transformations des services publics français, à l’occasion du séminaire annuel de l’association Réseau Prospective territoriale1.
Co-autrice des ouvrages La valeur du service public et La haine des fonctionnaires2, elle a attiré l’attention sur trois ruptures majeures dans l’histoire des services publics, riche d’enseignements pour imaginer les services publics de 2040.
BIO EXPRESS
1996
Diplômée de Sciences Po
2001
Docteure en histoire après une recherche sur les chambres de commerce
2010
Devient membre du Centre de sociologie des organisations
2021
Publie avec Julie Gervais et Willy Pelletier La valeur du service public (La découverte)
2024
Publie avec les mêmes La haine des fonctionnaires (Éditions Amsterdam)
Votre travail d’historienne, au carrefour de la sociologie et de la science politique, offre une perspective précieuse sur l’évolution des services publics en France, en montrant que « la trajectoire du passé n’a pas été linéaire » et qu’il est…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner