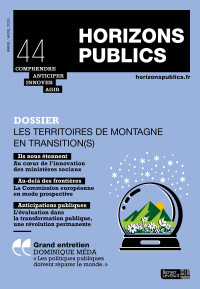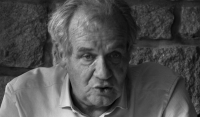Sociologue, philosophe, professeure à l’université Paris Dauphine, Dominique Méda a dirigé pendant dix ans l’Institut de recherches interdisciplinaires en sciences sociales (IRISSO) de Dauphine. Dans Une société désirable. Comment prendre soin du monde, elle décortique les idées reçues sur le travail, l’emploi et l’État-providence, et envisage les mutations nécessaires pour opérer une véritable reconversion écologique.
BIO EXPRESS
1989
Membre de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) à la sortie de l’École nationale d’administration (ENA)
1995
Publication de l’ouvrage Le travail. Une valeur en voie de disparition ?1
2010
Professeure de sociologie à l’université Paris Dauphine
2014-2023
Directrice du laboratoire de sciences sociales de Dauphine
2024
Publication du livre Une société désirable. Comment prendre soin du monde2
Nous vivons trois crises : la crise du travail, la crise de l’État-providence et la crise de l’écologie. Comment sont-elles interconnectées ?
La plus grave c’est la crise…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner