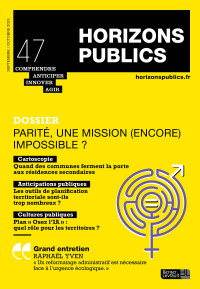Pionnière depuis les années 1990, Vienne (Autriche) intègre le genre dans l’aménagement urbain, notamment à Aspern Seestadt. À Grenoble, la majorité écologiste agit pour une cité plus égalitaire. Ces deux villes ont intégré la démarche sensible au genre, ou gender mainstreaming, dans l’urbanisme, les transports et l’espace public.
Vienne, ville pionnière en matière d’égalité femmes-hommes
À Vienne, tout commence dans les années 1990 par une exposition intitulée « Qui possède l’espace public ? ». Les femmes se réjouissent de constater qu’elles ne sont pas les seules à trouver la ville difficile à utiliser. En revanche, les responsables de l’urbanisme et du design de la ville n’apprécient pas vraiment le sujet, s’indignent et osent même dire avec ironie que la prochaine exposition portera sur la place des chiens dans l’espace public. À l’époque, on ne comprend pas vraiment en quoi la ville est complexe à appréhender pour…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner