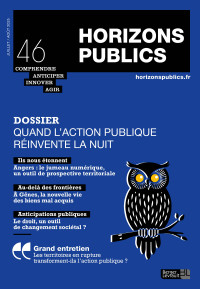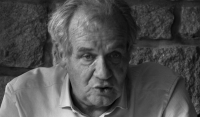Revue
Grand entretienLes territoires en rupture transforment-ils l’action publique ?

Dans le cadre du lancement du 6e ouvrage de la chaire Transformations de l’action publique, Les territoires qui disent non ! Mobilisations et mutation de l’action publique (Berger-Levrault), la Public Factory de Sciences Po Lyon1 a organisé le 10 juin dernier une soirée-débat à bâtons rompus.
Les codirecteurs de l’ouvrage, Renaud Payre, Christian Paul et Christophe Parnet, ainsi que de nombreux contributeurs, ont discuté de l’évolution des relations entre mobilisations territoriales et action publique, dépassant la seule logique conflictuelle.
De Creys-Malville aux zones d’aménagement différé (ZAD), en passant par les oppositions aux projets d’énergies renouvelables, ce livre examine la façon dont les territoires réagissent aux projets, qu’il s’agisse de manifestations contre des infrastructures ou des énergies renouvelables. Il explore les méthodes d’appropriation et de protestation employées, ainsi que la réponse des autorités publiques à ces oppositions. Horizons publics vous en restitue les principaux échanges.