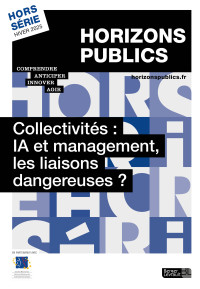Revue
Grand entretienBrieuc du Roscoat : «L’IA ne doit pas être vue comme un élément de productivité, mais de bien-être au travail»

Président de l’Institut pour la transformation et l’innovation (ITI), Brieuc du Roscoat mène un projet de recherche sur l’intelligence artificielle générative (IAG), ses effets sur le management et la prise de décisions. Il attire notamment l’attention sur le fait que « l’IAG peut devenir rapidement un nouveau sujet de fracture considérable en France si une petite élite se l’approprie et l’impose d’en haut, comme cela s’est fait pour la dématérialisation des démarches administratives ». Selon lui, il est indispensable de former les cadres et les agents à l’utilisation de l’IAG.