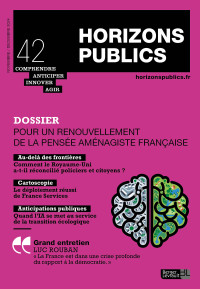Existe-t-il un rapport entre la société fragmentée et fracturée, celle dont le diagnostic passe pour acquis aujourd’hui, et les quarante ou soixante dernières années d’urbanisme à la française ? Ce dernier aurait-il une responsabilité dans les fractures qui passent désormais pour le descripteur premier de tout tableau social de la France ?
Résumé
On dénonce partout les fractures de la société française, mais est-on prêt à en finir avec l’urbanisme fragmentaire qui les a nourries depuis au moins deux générations ? Un premier pas consisterait à reconnaître que les modèles qui guident toujours l’aménagement de l’espace local et l’urbanisme ne font pas du bien à la cohésion sociale et territoriale. S’ouvrirait alors un urbanisme de la reliance dont les modalités et les figures sont déjà à portée de main.
Il est étonnant de constater qu’il n’est que très rarement, voire jamais, fait de rapport entre l’état de la société et l’espace…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner