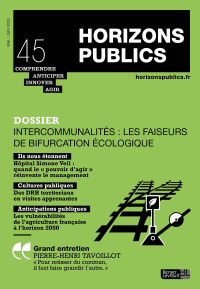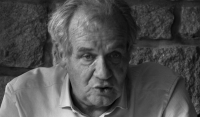Revue
DossierLa robustesse pour continuer à habiter nos territoires
Compétitivité débridée, flux tendu, agriculture de précision, smart cities, etc. Paradoxalement, l’âge de l’optimisation, de la performance et du contrôle rend notre monde toujours plus fluctuant : mégafeux, dérive sécuritaire, guerre mondialisée. En nous inspirant des êtres vivants, nous pourrions apprendre une autre façon d’habiter la Terre. Alors que les sociétés humaines modernes ont mis l’accent sur l’efficacité et l’efficience au service du confort individuel, la vie se construit plutôt sur les vulnérabilités, les lenteurs, les incohérences, etc., c’est-à-dire des contre-performances au service de la robustesse du groupe. Un contre-programme ? Entretien avec Olivier Hamant, biologiste à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), chercheur à l’École normale supérieure (ENS) de Lyon et auteur d’Antidote au culte de la performance. La robustesse du vivant1.