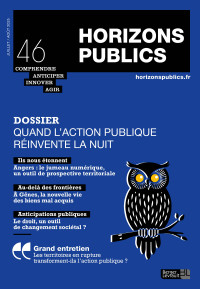Longtemps réduite aux marges du regard scientifique, la nuit africaine s’impose depuis le tournant des années 2000 comme un objet de recherche à part entière. Entre pratiques rituelles héritées, veillées religieuses, travail et mobilités nocturnes en plein essor, mais aussi explosion des lieux festifs modernes, elle révèle toute l’ambivalence de sociétés conservatrices confrontées aux mutations urbaines. Un espace-temps où se croisent repos et inquiétudes, rites et loisirs, intimité et effervescence publique — et qui interpelle désormais directement les politiques urbaines.
Les nuits en Afrique en apparaissent dans les travaux en sciences sociales à partir des années 2000 (Phillys Martin, 2005 ; Fouquet 2018, 2020 ; Owonda Ndounda ; 2023 ; Diouf et Fall (2021). Les travaux des islamologues et sociologues sur l’Islam, ou encore sur les mobilités quotidiennes (travaux du LAET) sont aussi des sources parcellaires.
Les travaux font apparaitre le paradoxe de sociétés africaines conservatrices confrontées aux mutations urbaines. Le jour, serait le temps du labeur et des interactions collectives et la nuit à contrario celui d’une part positivée du repos, de la…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner