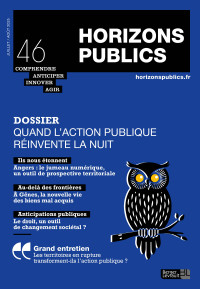Si l’on connaît de nombreuses dimensions des mobilités quotidiennes (modes, motifs, distances et durées des déplacements)1, les horaires au cours desquels les mobilités se réalisent ont fait l’objet de moins d’attention. Or, ce sont les mobilités diurnes, concentrant les phénomènes de congestion, qui sont analysées alors que les mobilités nocturnes, envisagées relativement à l’accidentologie ou au seul espace urbain2, sont passées sous silence.
Pourtant, les mobilités quotidiennes ont connu des bouleversements de grande ampleur : l’essor du travail de nuit, la féminisation et la diffusion de la conduite automobile3, mais aussi la désynchronisation des emplois du temps en lien avec la multiactivité4 au sein des couples, sont tant de facteurs qui peuvent affecter les individus à se déplacer la nuit. Or, ces déplacements sont bien différents des déplacements réalisés en journée : connaissant une offre de transports réduite, la nuit est souvent perçue comme dangereuse, en particulier pour la conduite automobile ou pour les femmes5…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner