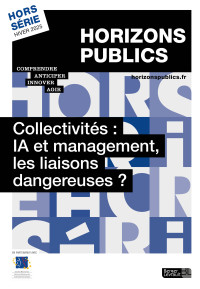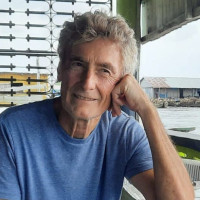Enjeu de la donnée, enjeu de territoire, enjeu de la sobriété, enjeu managérial, etc. Quelle est la place de l’intelligence artificielle (IA) dans nos stratégies territoriales ? De quelle manière prendre le meilleur de l’IA dans nos organisations, sans avoir à subir mais plutôt à adapter ? L’un des risques d’une utilisation mécanique et paresseuse de l’IA n’est-il pas son effet cognitif sur notre capacité à raisonner, en laissant la machine le faire à notre place ? Telles furent, parmi d’autres, les questions au centre d’un débat (voir notre encadré) au programme de la dernière édition de Territorialis à Tours.
« IA et management, entre vrais enjeux et fausses peurs » avec :
Akim Oural, président de Eymaak Smart Innovation ;
Alexandre Jost, fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza ;
Aissia Kerkoub-Türk, directrice générale adjointe, secrétaire générale de la ville de Lyon, animé par Hugues Périnel, journaliste et fondateur du Cercle des acteurs territoriaux.
La question stratégique de la gouvernance de la donnée
Fonctionnement en silo à trop de niveaux, peu de coopération entre les collectivités locales et les partenaires du territoire, redondances dans les activités de chacune, des…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner