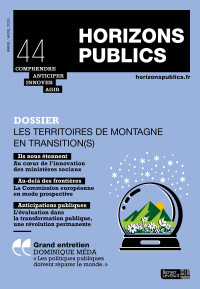La relance du thème de l’évaluation des politiques publiques à la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) est un bon moment pour interroger la place de cette pratique au sein des stratégies de la transformation publique. Miracle ou mirage, nous avons donné la parole à Paul Cotton qui vient de soutenir une thèse qui étudie les raisons des échecs de l’institutionnalisation durable de l’évaluation en défendant l’idée d’une révolution permanente de cette dernière.
Une thèse pour comprendre la non-réactivation de l’évaluation comme outil d’amélioration de l’action publique
Lorsque l’on parle de transformation de l’action publique, deux images viennent en tête assez rapidement. D’un côté, une image classique, économique de la transformation publique, avec sa rationalisation souvent synonyme de coupes budgétaires tous azimuts soutenues par des exercices d’audit ou de revue des dépenses. De l’autre, une image plus moderne, celle de l’innovation publique, une exploration qui tente de convertir laborieusement l’administration à des pratiques quasi futuristes…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner