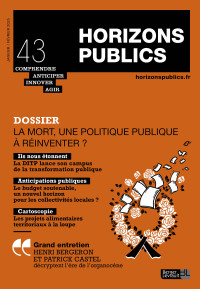Si la majorité des Français continuent à être inhumés, ils sont de plus en plus nombreux à choisir la crémation, signe d’un recul du religieux, détachement des racines, et prise en compte d’enjeux économiques et écologiques qui viennent là aussi modifier nos habitudes. Au point d’envisager peut-être, prochainement, de nouvelles pratiques comme l’humusation (laisser des microbes décomposer les corps en humus), ou l’aquamation (qui permet de dissoudre les corps dans une solution aqueuse) ? Entretien avec Martin Julier-Costes, spécialiste de la mort et des rites funéraires.
Martin Julier-Costes
Socio-anthropologue, spécialiste de la mort et des rites funéraires, Martin Julier-Costes est chercheur associé au laboratoire de sciences sociales Pacte, à l’Université Grenoble Alpes.
Au côté de la sécularisation de notre société, la crémation a connu aussi un essor très important, son taux en 1980 était de 1 %, il est aujourd’hui de 43 %.
Quelles sont les évolutions sociétales par rapport à la mort et au deuil que vous pouvez observer en tant que chercheur ?
C’est une question vaste, les chercheur·ses en sciences sociales s’accordent sur plusieurs transformations :…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner