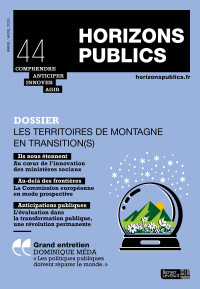Revue
DossierTransition en montagne : quand le climat fait monter la température sociale
Le changement climatique ne peut être considéré comme un événement à gérer ou comme un problème à résoudre. Il constitue le monde dans lequel nous vivons. La montagne, en raison de ses caractéristiques, est confrontée plus tôt que d’autres, ou avec plus d’intensité, aux effets du changement climatique qui peuvent compromettre son modèle de développement. Dans ces conditions inédites, comment appréhender des futurs qui ne dépendent pas des solutions existantes ? Alors que les réponses actuelles divisent, l’accentuation du réchauffement climatique laisse augurer l’augmentation des conflits en montagne. Dans ce contexte, s’organiser face au défi social et économique majeur que représente l’adaptation au réchauffement du climat paraît inévitable, quels que soient les efforts d’atténuation à réaliser.