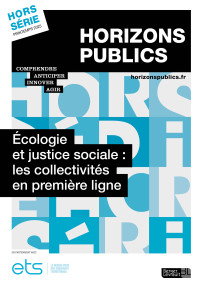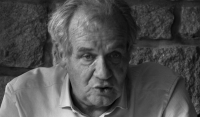L’association Futuribles International vient de publier une note d’analyse prospective sur « L’État et les territoires dans la transition écologique en 2040 ». Yannick Blanc, son président, revient sur les trois scénarios prospectifs imaginés par les auteurs de cette note. À l’horizon 2040, le rôle des collectivités locales pourrait se renforcer, selon l’un des scénarios (« Les écosystèmes coopératifs »). L’objectif de cette note est d’alimenter le débat public, notamment en vue des élections municipales de 2026, en soulignant le potentiel de transformation de l’échelon local.
Vous avez initié une démarche de prospective sur les relations entre l’État et les territoires. Pouvez-vous nous éclairer sur les raisons qui vous ont poussé à entreprendre ce travail et sur les objectifs que vous visez ?
L’idée était de dépasser et de sortir du débat récurrent sur le mille-feuille territorial, la lourdeur de l’organisation administrative et les différents niveaux d’administration. Ce débat, vieux de plus de quarante ans, est alimenté de manière circulaire alors que les enjeux et besoins ont changé. La décentralisation de 1982 a transformé les enjeux locaux. Alors qu’à l…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner