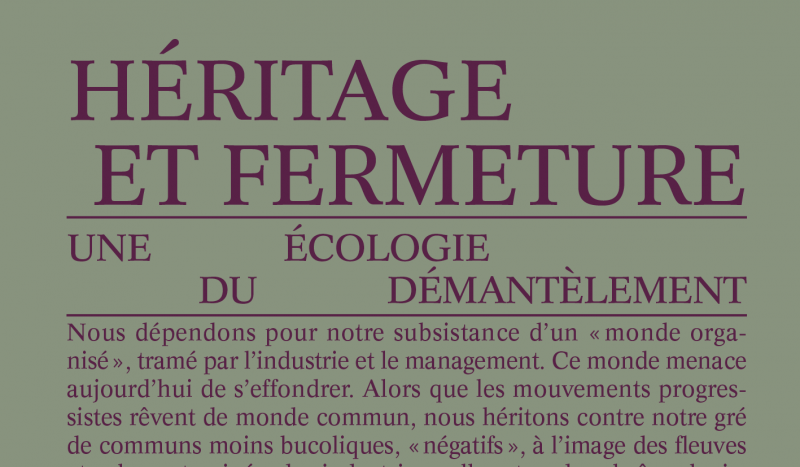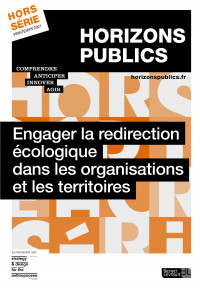Entretien avec Alexandre Monnin, directeur du MSc « Stratégie & Design pour l'Anthropocène », qui vient de publier, avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, Héritage et fermeture. L’écologie du démantèlement (juin 2021, Divergences).
L’acceptation de l’hypothèse anthropocène est en train de bouleverser le champ scientifique. On sait que le mot est au départ censé désigner une nouvelle époque géologique qui succède à l’holocène, laquelle aurait été causée par les activités humaines. Mais, avant même que cette hypothèse géologique soit validée, le terme s’est répandu en particulier dans les sciences humaines et sociales. Comment te positionnes-tu par rapport à cette émergence ? Qu’entends-tu précisément par « anthropocène » et comment ce concept te permet-il d’outiller tes travaux et ta pensée ?
Le mot « anthropocène »…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner