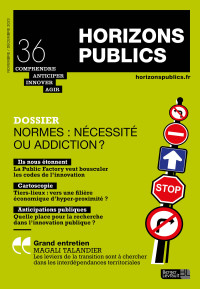Françoise Gatel, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et co-rapportrice du rapport d’information, Normes applicables aux collectivités territoriales : face à l’addiction, osons une thérapie de choc !, avance plusieurs propositions pour réduire la prolifération des normes.
Résumé
L’état des lieux des normes applicables aux collectivités est très préoccupant. L’inflation normative complexifie les projets locaux, retarde leur réalisation et augmente significativement les coûts. Elle constitue ainsi, trop souvent, un frein au développement des territoires. De nombreux travaux sur le sujet – qui demeure en tête des priorités des élus – ont été menés, mais le chantier est immense.
Aussi, la délégation aux collectivités et à la décentralisation du Sénat a choisi de s’intéresser à la fabrique même de la norme, s’inspirant d’une démarche qualité pour qu’elle soit…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner