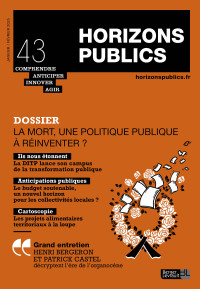Les collectivités locales font aujourd’hui face à un silence assourdissant sur les questions funéraires. Si l’on ne se fie qu’à ce qui se dit en réunion publique ou dans les permanences des élus, on pourrait croire que les enjeux de sécurité, de logement, de voirie et d’emploi constituent les seuls marqueurs des attentes exprimées par les habitantes et habitants. Parce que la mort, on l’écrit, faute d’avoir des espaces pour en parler.
Les services d’état civil le savent bien, leurs agents sont confrontés à des lettres et mails emplis d’émotions qui évoquent l’absence de salles adaptées pour des cérémonies d’obsèques civiles, des adieux dans des cimetières battus par la pluie et le vent où, faute de barnums, de préaux ou de squares, il faut s’accrocher autant à sa tristesse qu’à son parapluie, ou encore des deuils périnataux avec des dépouillesprises en charge par l’hôpital, ce qui, de fait, empêche l’inscription de la brève vie de l’enfant dans un lieu de mémoire et de recueillement.
Il existe souvent des plans de…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner