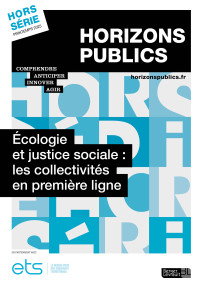Revue
DossierComment bénéficier de l’implication de la jeunesse pour transformer nos organisations ?
Nos administrations doivent amorcer de profondes transformations pour répondre aux urgences de notre siècle, et aux aspirations de la jeunesse qui formule des attentes fortes en termes de transition écologique alliées à des formes nouvelles et variées d’engagement. Depuis quelque temps déjà, les secteurs public et privé cherchent à s’adapter aux nouvelles générations pour les attirer, mais aussi pour tirer parti de cette jeunesse. Les jeunes veulent prendre toute leur place dans les organisations, y compris participer aux décisions les plus stratégiques, pour lesquelles ils se sentent légitimes. Cette situation génère un paradoxe à dépasser : nous avons besoin des jeunes, de leur créativité et de leur implication, alors même qu’ils sont souvent les moins expérimentés. Comment faire ? Décryptons ensemble ces attentes : quelles sont-elles ? Comment se manifestent-elles ? Qu’engendrent-elles ?