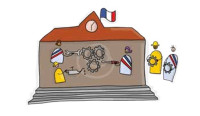Revue
Anticipations publiquesEwen Chardronnet : « Comment les nouvelles données citoyennes peuvent façonner la ville de demain »

Rédacteur en chef du magazine en ligne Makery, spécialisé sur la culture des fab labs, de la biologie associative et de la culture « Do it yourself » (DIY) en général, Ewen Chardronnet invite citoyens et artistes à s’approprier et à exploiter les données pour agir sur les territoires. Selon lui, fab city et smart city sont deux philosophies distinctes d’exploitation des données publiques pour les villes de demain. Ewen Chardronnet a donné une conférence au POLAU le 13 décembre 2018 autour des relations entre data, arts et territoires. C’est à cette occasion que nous l’interrogeons sur les usages publics, citoyens et artistiques des données publiques urbaines.