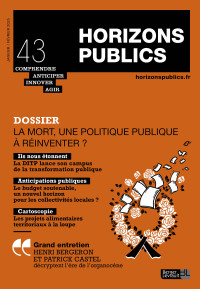Le projet de loi relatif à l’accompagnement de la fin de vie a replacé la mort dans l’espace public. Cependant, les débats ont occulté l’impact de la perte d’un proche sur les personnes qui restent après le décès et aucune mesure publique de soutien des endeuillés n’a véritablement émergé. Une invisibilisation qui s’inscrit dans une longue tradition d’ignorance du deuil par les pouvoirs publics.
Résumé
Les travaux que nous menons avec des acteurs qui accompagnent le deuil (tels que l’association Dialogue et solidarité, les institutions de prévoyance ou l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance [OCIRP]) font ressortir l’absence de politique publique transversale en faveur des personnes endeuillées. Certes, des cadres réglementaires existent notamment autour de la question des funérailles, des successions ou des congés en entreprise, mais ils ne concernent finalement qu’une période resserrée de la vie de l’endeuillé et très rapprochée du moment du décès du proche…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner