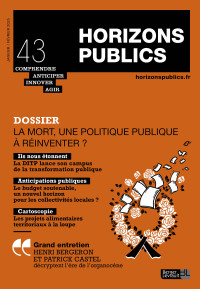Revue
Anticipations publiquesLes EPL pourront-elles continuer à jouer leur rôle de leviers de la transformation écologique ?
La Fédération des élus des entreprises publiques locales (FedEpl) organise chaque année son congrès. C’est à Nantes que les élus et les dirigeants des sociétés d’économie mixte (SEM), des sociétés publiques locales (SPL) et des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP) se sont retrouvés (8-10 octobre 2024). L’occasion, entre autres, de s’interroger sur les leviers locaux mobilisables pour aller dans le sens d’une transformation et d’une planification écologiques. Les entreprises publiques locales (EPL) disposent d’un savoir-faire qui peut s’avérer précieux pour adapter notre cadre de vie aux nouvelles exigences imposées par le réchauffement climatique. Mais l’état des finances locales pourrait porter un coup d’arrêt à cette ambition.