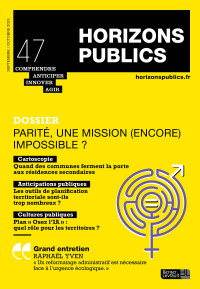Techniquement, en France, les femmes et les hommes ont les mêmes chances en matière économique. Mais dans les faits, au cours de leurs vies, les femmes ne font que s’appauvrir, jusqu’à atteindre des pensions de retraite 38 % plus faibles que celles de leurs homologues masculins. Zoom sur les mécanismes de cette inégalité et le rôle de l’État dans sa perpétuation.
Étudier, travailler, détenir un compte en banque, etc. Dans les faits, en 2025, les femmes ont les mêmes droits économiques que les hommes. Pourtant, elles restent globalement plus pauvres : en 2020, la note « Égalité hommes-femmes : une question d’équité, un impératif économique » du Conseil d’analyse économique (CAE)1 chiffrait à environ 30 % l’écart de revenus entre les deux genres, et à tous les niveaux de qualification et de salaire. Côté patrimoine, même constat : d’après l’Institut national d’études démographiques (Ined)2, non seulement elles en ont moins, mais l’écart s’accentue…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner