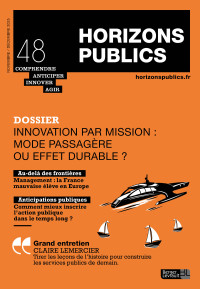Depuis 2017, les Pays-Bas testent une manière inédite de transformer leur système de santé : Health~Holland. Une mission nationale claire, cinq missions secondaires mesurables, des partenariats publics-privés au niveau national et des labs territoriaux pour expérimenter au plus près des habitants. À la clé : déplacer des soins « au bon endroit », faire de la prévention un réflexe de quartier et impliquer les habitants dès le départ. Voici comment ça fonctionne vraiment, ce que cela change et ce que l’exemple de la ville de Deventer nous apprend avec l’expérimentation « Le bonheur dans le quartier » (Buurtgeluk).
L’innovation pour la santé
Fin 2010, les élections au Parlement des Pays-Bas entraînent une négociation pour constituer un contrat de gouvernance. Celui-ci comprend une stratégie de recherche et développement Naar de top (« Vers le sommet »), mise en œuvre par le ministère des Affaires économiques. L’objectif est de modifier le financement de l’innovation pour permettre aux entreprises néerlandaises d’accéder aux marchés mondiaux. Cette stratégie fut amendée, en 2017, lors du contrat de gouvernance suivant : les neuf secteurs prioritaires sont réorganisés afin de répondre à une logique de…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner