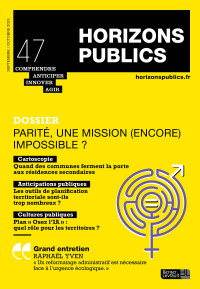Entretien avec Pauline Chabbert, co-fondatrice et directrice associée du groupe Egaé1, qui accompagne les organisations publiques dans la prévention et le traitement des violences sexistes et sexuelles (VSS).
Pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amenée à travailler spécifiquement sur la prévention des VSS ?
J’ai débuté ma carrière au ministère des Affaires étrangères, où j’étais responsable des questions d’égalité, principalement sur le volet diplomatique et de coopération. En 2013, j’ai créé ma propre auto-entreprise pour travailler en tant que consultante sur les questions d’égalité femme-homme. Puis, en 2015, nous avons lancé le groupe Egaé avec mon associée, Caroline De Haas. Initialement, nous nous concentrions sur l’égalité femmes-hommes, mais très rapidement, la…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner