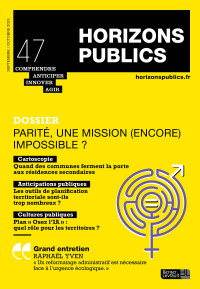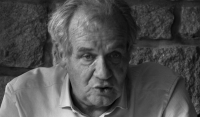C'est le titre d'une émission proposée par Weka TV en partenariat avec la CASDEN Banque populaire que nous avons souhaité relayer dans ce dossier1. Souvent présentée comme une technologie neutre et objective, dont l’illusion de rationalité des algorithmes serait la preuve, l’intelligence artificielle (IA) est en réalité un artefact social, profondément influencé par les structures de pouvoir qui régissent nos sociétés. Construire la neutralité de l’IA est une urgence démocratique.
L’IA, selon le Parlement européen, désigne « la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité » 2. Elle permet à des dispositifs techniques d’analyser des données et d’agir de manière autonome dans un environnement donné. Présentée comme un levier d’innovation, de performance et de rationalisation, l’IA est souvent perçue comme neutre, objective et apolitique.
L’IA est profondément façonnée par celles et ceux qui la conçoivent, la codent, la déploient et l’utilisent. L’IA n’est pas neutre, elle est…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner