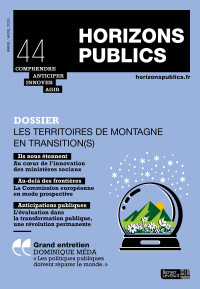Le 19 novembre dernier, au Congrès des maires, un forum était consacré à la politique sportive telle qu’elle se dessine quelques semaines après le franc succès des Jeux olympiques et paralympiques parisiens1. Comment « saisir la balle au bond après les Jeux », pour reprendre l’intitulé du forum, à l’heure où les finances publiques, elles, ne présentent pas une forme olympique ? Plusieurs maires ont ainsi pu s’exprimer, explorant les pistes pour confirmer ce bel allant national tout en confiant leurs craintes sur le soutien financier de l’État.
Pour qu’une telle réussite puisse survenir, plusieurs leviers doivent être activés simultanément. L’un de ceux dont on a le moins parlé, focalisés que nous étions tous sur les exploits de nos athlètes, c’est celui de la mobilisation des communes. « Les maires sont convaincus de l’importance du sport dans leur vie communale », a rappelé, comme une évidence, David Lazarus, co-président de la commission du sport de l’Association des maires de France (AMF) et maire de Chambly (Oise). Bien en amont, les communes ont en effet préparé le terreau d’un tel succès. Le label Terre de Jeux 2024, créé par…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner