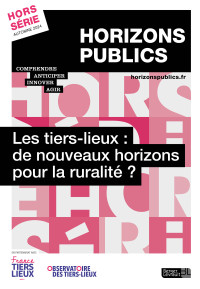En octobre 2018, le mouvement des Gilets jaunes révèle l’exaspération des campagnes françaises, à la suite d’une proposition de taxe sur le prix du carburant. Bientôt pourtant, les débats portés sur les ronds-points s’étendent au-delà des premières revendications pour dire la colère, l’épuisement, et le sentiment d’abandon de celles et ceux qui habitent les territoires ruraux. Six ans plus tard, la France reste marquée par une fracture sociale et politique de plus en plus profonde, et une défiance croissante à l’égard de nos institutions démocratiques.
Ruralités : réalités multiples, enjeux communs ?
Si, comme nous le dit Maud Picart dans l’article « Tiers-lieux en ruralité, de quoi parle-t-on ? » 1, la ruralité peut désigner autant un indicateur de densité, un type de paysage ou d’activité, de zones très attractives à d’autres, peu denses, de certaines en reconversion à d’autres en déclin, les campagnes françaises recèlent pourtant de réalités plurielles, interdisant une analyse monolithique et uniforme de leurs enjeux. Pourtant, s’il existe autant de réalités de la ruralité que de contextes donnés, les ruralités françaises semblent…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner