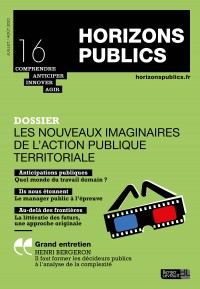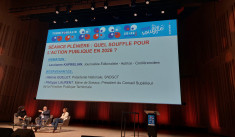Interne de santé publique au CHU de Caen-Normandie, Pierre Breton a rejoint en octobre 2020 la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) au ministère de la Santé à Paris. Co-auteur avec Quentin Paillé de La ville, actrice de santé (sept. 2020), il considère que la crise du covid-19 confirme le rôle et l’importance de l’échelon local pour mener des actions de santé.
Quel est le message principal que vous avez voulu faire passer avec cet ouvrage ?
La santé, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), signifie « un état complet de bien-être physique, mental et social » qui ne « consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ». Cette définition montre que la ville, même si elle n’a pas la compétence en matière de santé, peut agir directement par ses actions sur les déterminants de santé de ses habitants. Aménagement, urbanisme, éducation, sports, culture, sécurité, social ou encore environnement sont des compétences municipales. Aujourd…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner