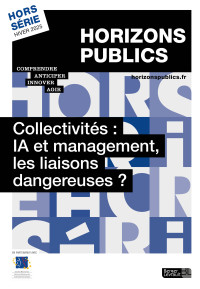Les 3 et 4 octobre 2024, plus de 1 600 dirigeants territoriaux se sont réunis à Tours pour les assises nationales Territorialis, un événement phare organisé par le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT). Sous le thème « Résilience et connexions dans un monde en transformation », cette édition record a abordé l’impact de l’intelligence artificielle (IA) dans les collectivités sous différents angles : technologique, stratégique, humain et en lien avec la gouvernance.
Ces deux jours intenses ont été marqués par des sessions de formation continue, des conférences plénières, des ateliers thématiques, un village des talents, un parcours dédié aux secrétaires généraux de mairie, et par la présence de soixante-dix exposants. Chaque année, cet événement national accueille des élus et cadres de la fonction publique, venus de tout l’écosystème public, privé et universitaire.
Comment garder la main en tant que directeur général des services (DGS) face à la révolution de l’IA ? Comment accompagner les cadres et les agents publics dans l’appropriation des outils d…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner