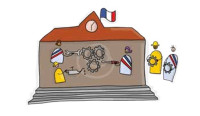Revue
DossierDéserter et bifurquer : la technique seule ne répondra pas aux crises
Le 30 avril 2022, des étudiant·es d’AgroParisTech lançaient un appel retentissant à « déserter » les emplois auxquels leur diplôme d’ingénieur·es les promettaient et à « bifurquer ». Leur appel témoignait d’une certaine désaffiliation avec un système qui empêche la soutenabilité de la société, et invitait à « cesser de nuire ». Il engageait également à l’action et à la construction d’alternatives, de capacités critiques et d’une repolitisation nécessaire dans le rapport à la technique, à la science et à l’enseignement. Croisant leurs regards d’ancienne étudiante et de professeur d’AgroParisTech, Éléa Lascourrèges-Berdeü et Bruno Villalba reviennent sur cet appel pour interroger les conditions nécessaires à un enseignement dans les grandes écoles qui serait à la hauteur des enjeux et des crises.