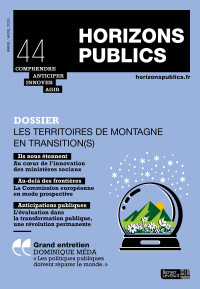Mikaël Chambru, Kirsten Koop et Jean-Baptiste Grison travaillent au laboratoire d’excellence « Innovations et transitions territoriales en montagne » (Labex ITTEM) implanté à Grenoble. Ce labo vient de lancer un nouveau cycle de recherche axé sur la soutenabilité des transitions territoriales des territoires de montagne.
Mikaël Chambru
Coordinateur scientifique du Labex ITTEM, il est maître de conférences en sciences sociales à l’université Grenoble Alpes. Ses recherches portent sur les changements socio-environnementaux en montagne, les controverses autour de la transition écologique et les modalités de mises en public des sciences.
Nous favorisons tout particulièrement la recherche collaborative aux côtés de partenaires territoriaux (parcs, collectivités territoriales, associations, etc.).
Pourriez-vous nous rappeler le rôle de votre laboratoire ? Ses missions, son périmètre d’action, ses spécificités ?…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner