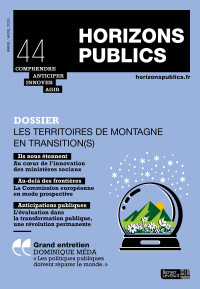La Société française de prospective, la Société française de l’évaluation et les Entretiens Albert-Kahn, laboratoire d’innovation publique du département des Hauts-de-Seine, ont organisé, le 7 novembre 2024, une journée de partage sur les démarches prospectives et évaluatives dans les territoires en transition écologique et sociétale (TES). Quelles sont les expériences innovantes dans ce domaine ?
Après une première rencontre consacrée l’an dernier à la place et au rôle des territoires dans la TES à différentes échelles spatiales et temporelles5, cette seconde journée d’échanges et de débat visait à éclairer les conditions du passage à l’action de ces territoires en direction d’une telle transition. Comme en 2023, nous avons marié retours d’expérience et mise en perspective méthodologique, cette dimension méthodologique étant ciblée cette année sur l’articulation des démarches prospectives et évaluatives mises en œuvre dans les territoires en transition.
Nous en soulignons quelques…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner