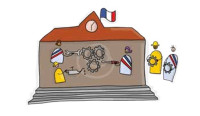Revue
DossierCommoneurs, administration, élu·es : quelle bonne distance ?
Les communs ouvrent aujourd’hui des espaces alternatifs entre les logiques du privé et du public, une autre culture politique et une autre façon de co-construire l’action publique. Charlotte Marchandise, maire adjointe déléguée à la santé et l’environnement de la ville de Rennes (2014-2020) et experte internationale en matière de santé (Organisation mondiale de la santé), Dominique Filatre, directeur général des services (DGS) et formateur dans la fonction publique territoriale et Frédéric Sultan, coordinateur de Remix the commons et du cahier de propositions politiquesdescommuns.cc, nous proposent une lecture de ces enjeux en croisant leurs différents regards de militant, d’élue et d’agent public territorial. Dépassant les postures qui enkystent et paralysent, ils lancent un appel aux nouveaux élu·es municipaux·ales à réunir ce qui est cassé et « faire commun ».